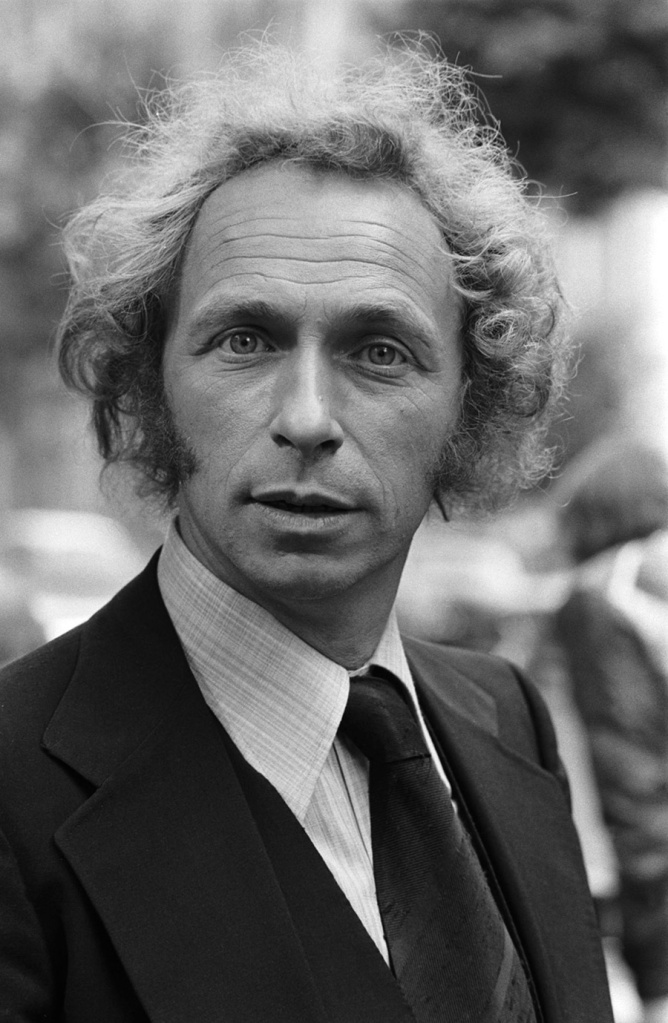Tout le monde fait mine de ne pas l’avoir remarqué, mais l’expérience du cinéma s’est discrètement retirée des possibilités offertes : il devient impossible, d’année en année, de se procurer la sensation particulière que l’on trouvait quand la salle de cinéma était encore une simple salle, les fauteuils de simples fauteuils non pourvus de bacs à pop-corn, quand la programmation était autre chose qu’un événement permanent de sorties « blockbuster » et leur cortège de remake-prequel-sequel-spin-off-crossover-reboot à rentabiliser les deux premières semaines, ou encore que le public cinéphile n’était pas cette anthropologie nouvelle venue chercher tout autre chose que du cinéma.
Le tout mis ensemble ôte jusqu’à l’envie de jeter un oeil à l’affiche pour vérifier s’il n’y aurait pas, au milieu de tout cela, quelque chose qui soit fait pour nous. Ou bien ma capacité d’émerveillement s’use avec l’âge, ou bien la salle obscure est objectivement devenue une salle d’obscurs abrutis autour de quoi toute l’industrie du cinéma s’est reconfigurée. Le guichet est devenu supermarché, les mufles arrivent à la séance les bras emplis de friandises à bouffer, mâcher, lécher, siruper, grignoter, froisser, déchirer, suçoter… Les fauteuils sont conçus pour leur aise et non la mienne : larges et vautrés, finalement accessoires par rapport à l’accoudoir qui est le vrai objet et doit permettre d’entreposer le seau à pop-corn ou à Coca-Cola le plus gros.
De fait, tout a été fait pour évaporer l’atmosphère fauteuils rouges et salle obscure. Dans le complexe cinématographique, le public ne ressent plus face à l’écran aucun devoir de révérence. Multi-abonné aux cartes ciné et plateformes Netflix, il n’y a plus rien d’exceptionnel ni de rituel, pour lui, à se rendre au cinéma : cela s’inscrit dans la continuité multi-screen responsive de sa consumer journey. Le film de cinéma est pour lui une vidéo comme une autre, sommée de soutenir son attention aussi habilement que le sketch qu’il a regardé juste avant sur tablette dans le métro, et que la série qu’il regardera ce soir sur son ordinateur de genoux allongé dans son lit. Les nouveaux cinéphiles se rendent au cinéma aussi négligemment qu’ils rejoignent une réunion sur Teams : comme s’ils étaient chez eux, ils parlent entre eux à voix haute et ne se taisent pas avec l’extinction des lumières, ils continuent bien après les bandes-annonces qu’ils estiment avoir déjà vues sur internet, et après que le film ait commencé jusqu’à temps que le premier personnage donne sa première réplique. Ils ne voient rien d’extraordinaire à ce que ce divertissement à plusieurs millions de dollars faisant appel, pour leurs beaux yeux, aux dernières prouesses de la technique et aux limites extrêmes de la technologie, arrive jusqu’à eux, ni qu’il ait engagé tant d’efforts dans le seul but de leur faire passer deux petites heures sans regarder leur téléphone. Leur gratitude tient déjà toute entière dans le fait de ne pas l’avoir téléchargé illégalement.
Prenant acte de ce nouveau public, le film se conçoit lui-même désormais non comme une oeuvre qui sollicite l’attention du public mais comme une expérience qui viole cette attention et doit la retenir par la force des moyens : de l’expérience du cinéma, nous sommes passés au cinéma de l’expérience. Le film doit tout donner le temps de la séance, en envoyer plein les mirettes d’un bout à l’autre, tant pis s’il n’en reste rien le lendemain. Ainsi, après les films pensés pour la 3D, voici le nec plus ultra de l’innovation cinématographique : le 4DX. Il s’agit d’une salle de projection spécialement aménagée de rangées de sièges, plus énormes encore et montés sur verrins. Comme au Futuroscope il y a 20 ans, les sièges ainsi que diverses installations travaillent à renforcer par des « effets » les mouvements et les émotions que le film est censé produire, tout au long de la séance. Quand le héros chute, le siège fait un soubresaut, s’il est à bord d’un bateau un brumisateur postillonne des particules d’eau, si les protagonistes entament une poursuite, un ventilateur souffle du vent, si une fusillade se déclare, de petits souffles d’air comprimé sifflent aux oreilles « comme si on y était »…
L’expérience est totalement « immersive », et évidemment grotesque. Car pour ce qui est du rendu, il faut s’imaginer qu’un type faufilé derrière votre fauteuil vous bascule à droite ou à gauche au fil de l’action que suggère la pellicule. Lorsqu’un coup de feu retentit, il le marque par un coup de pied dans le dossier. Lorsqu’une voiture fait un tonneau, il vous secoue en tous sens… Et si malgré tout vous parvenez à rester concentré sur l’histoire jusqu’au moment où le héros embrasse la belle, le type vous souffle du sèche-cheveux dans la tronche pour souligner que la scène se déroule sur le toit d’un immeuble ! N’importe qui, en pareille situation, finirait par se lever, empoigner le type et le sommer d’arrêter sur le champ. Mais le 4DX, lui, ne s’attrape pas par le col ni par les cheveux, il n’a pas prise aux insultes, il continue durant toute la séance.
J’imagine qu’au prix où coûte l’installation, études de marché et tests consommateurs n’ont pas manqué de garantir l’existence d’une clientèle 4DX, pourtant il me semble que le dernier des spectateurs friands de sensations sucrées ne peut en sortir qu’aux cris de « Plus jamais ça ! » ou du moins « Marrant une fois, mais pas deux ! ». Le 4DX est au cinéma ce que les rires enregistrés étaient aux mauvaises séries télé : lorsque la machine à Spectacle en est ainsi réduite à surligner l’action, les dialogues, les sensations… par une décharge d’artefact technique sans laquelle l’oeuvre n’est plus capable de déclencher un rire, un pleur ou un émoi, c’est que l’on touche le fond. Le niveau zéro du cinéma bien entendu, mais aussi de l’entertainment lui-même. Arrivé là, c’est la fin. Ou le début de quelque chose d’autre : le début peut-être d’une ère où la machine tient en bâtiment clos un élevage industriel de poulets-spectateurs semi-dépressifs, mécaniquement bercés dans des fauteuils et bombardés de stimulis ludo-mécaniques et ludo-chimiques pour tirer ce qu’il leur reste de semence.
Que de moyens employés pour soustraire le consommateur à son existence, le garder assis et qu’il se tienne sage !