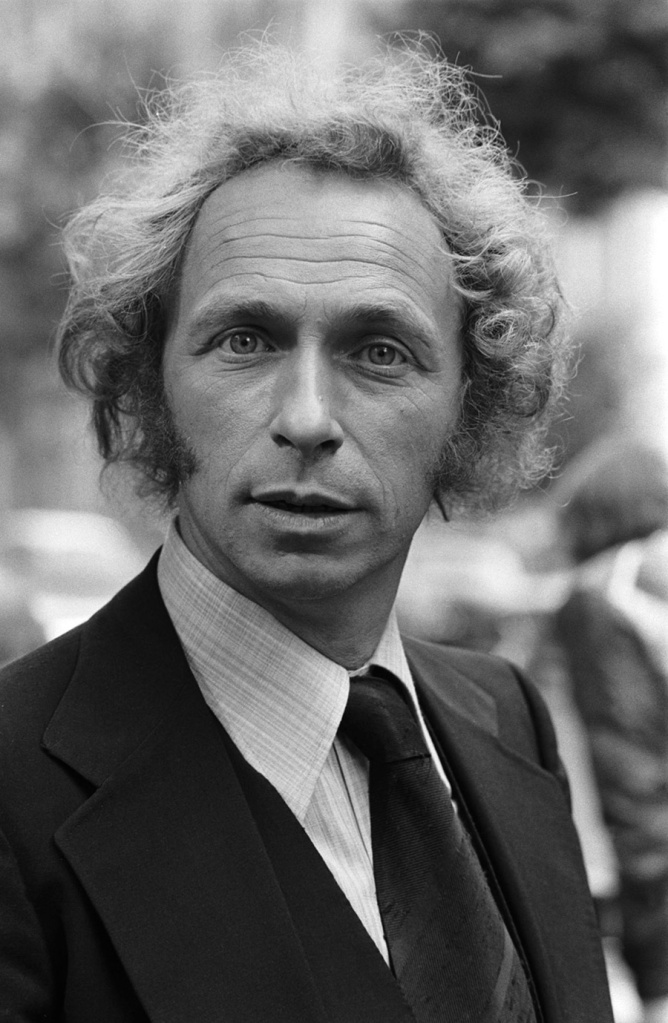Au long des années soixante-dix, le cinéaste Francis Veber pose l’archétype de L’Emmerdeur, à travers un personnage emblématique qui reviendrait dans plusieurs films, sous plusieurs identités et l’interprétation de plusieurs comédiens, mais toujours pour incarner une seule et même idée : François Pignon, l’homme du quotidien, ingénu et discret, qui malgré son inhibition, vient perturber le fonctionnement du monde par sa maladresse ou sa bêtise.
Veber lui-même expliquait la récurrence du personnage de cette façon :
“C’était toujours le même petit homme dans la foule, plongé dans une situation qui le dépasse et dont il parvient à se sortir en toute inconscience”.
L’Emmerdeur est ainsi l’individu banal, insignifiant, qui ne voulant déranger personne ni penser à mal, importune néanmoins par sa simple présence, et porte le chaos de façon involontaire au sein d’une situation stable, d’une société qui ne demande qu’à mener ses affaires. Un chien dans un jeu de quilles.
Si l’effet comique continue de fonctionner aujourd’hui, la figure sociologique de François Pignon ne correspond plus à une réalité tangible. La timidité maladroite, la pudeur sociale excessive, ne sont plus vraiment ce qui est à craindre ; la source de désagrément provient bien plus massivement d’une gêne et d’une inhibition sociales qui ont totalement disparu. Par rapport à ces films et cette époque, le rapport des choses s’est inversé. Si le monde est invivable, ce n’est plus du fait d’un emmerdeur isolé qui gripperait les rouages d’une société qui veut tourner rond, mais bien plutôt par la prolifération de bousilleurs, toujours plus bruyants, braillants et entreprenants, débridés par un cadre social qui les autorise et les encourage. Du point de vue de la société, le caillou dans la chaussure n’est plus le perturbateur atypique, mais l’individu statique, le Manant, celui qui ne demande pas son reste et ne souhaite pas prendre part à l’agitation.
C’est la révolution notable qui s’est accomplie ces soixante dernières années sans même qu’on la souligne : l’incroyable dépréciation de la valeur accordée au calme, à la discrétion, à la tranquillité, à l’habitude… au profit de la vitesse, du scandale, de l’impertinence ou de la compulsivité. Aujourd’hui, pour l’individu-type comme pour la morale publique, il faut emmerder pour exister : il ne saurait y avoir d’activité véritablement moderne qui n’ait pour effet d’importuner, il ne saurait y avoir de vie épanouissante en dehors de l’émancipation, de la revendication sur tous les toits ou de l’affirmation bruyante du soi. La paix profonde, la sérénité qu’enseigne la culture antique, n’intéressent plus personne au point qu’on songe à les retirer de l’enseignement, à les désapprendre. Chacun est invité à vivre, crier, bouger, devenir ce qu’il est, mener des activités à moteur, à casque et à sensations fortes. Chacun veut influer sur la vie des autres, positivement s’il le peut et sinon tant pis. Être remarquable et en tout cas remarqué, bousculer le monde c’est-à-dire l’emmerder, à la hauteur de ses moyens. « J’espère bien que je dérange » : voilà la maxime du bon citoyen, ce qui lui prouve qu’il existe, et qui constitue le fond de la nouvelle sagesse populaire. L’Emmerdeur d’hier est devenu l’emmerdé, et inversement.
L’autre jour, une collation était offerte à six participants, tous adultes et ayant eu, on suppose, une éducation pour leur apprendre les manières. Un premier François Pignon prévint qu’il ne mangeait pas de poisson ; deux autres pas de viande. Un dernier demanda les ingrédients qui entraient dans la composition de la sauce. Un tiers du groupe seulement accepta le repas prévu à leur effet. Cela donne une idée du rapport actuel entre Emmerdeurs et Emmerdés. Si les premiers sont restés minoritaires jusqu’à un certain point de la société civilisée, c’est que cette dernière pénalisait socialement leurs comportements par la culpabilité. Notre époque, en les tolérant progressivement, les a rendus acceptables et même désirables : en effet, l’Emmerdeur est plus souvent valorisé que son voisin taiseux et respectueux. Le bruyant passera pour plus entier et plus vivant. L’Emmerdeur à particularismes fera l’objet de plus de marques d’intérêt. Ses régimes spéciaux le présenteront comme rigoureux, sensible à la cause animale ou soigneux de sa santé. L’Emmerdeur à scandale sera plus visible et plus reconnu : lorsqu’il salopera un art par une oeuvre tonitruante et bâclée, on saluera l’avant-garde. L’Emmerdeur rebelle qui refuse d’obtempérer sera l’Homme qui a dit non. S’il geint, se plaint et demande réparation, il devient un véritable Justicier. Celui qui disrupte le marché et emmerde le code du travail sera un entrepreneur de génie. Et l’Emmerdeur qui décide de faire ses courses nu en bas-résilles sera le plus libre des Hommes : on demandera de ne pas le juger. On dira que ceux qui portent encore une culotte sont simplement ceux qui n’osent pas.