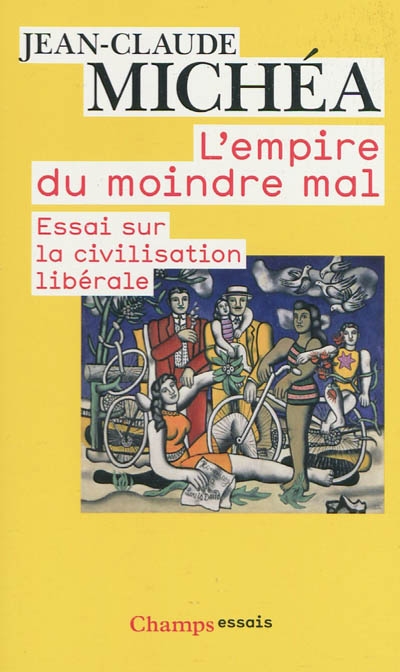Voici un disque un peu particulier déniché il y a quelques années, signé Vincent Delerm. Il est fait de chansons ponctuées de dialogues entre un enfant et son grand-père, lui expliquant ce que veut dire être de gauche.
La volonté pédagogique était-elle sérieuse ou prétexte à chansonnettes, toujours est-il que cet ovni dessine en creux le portrait de cette gauche, fille de la « gauche caviar », ne voulant plus entendre parler de socialisme, de travail, d’organisation politique ou économique, mais seulement se rattacher à un « mode de vie » fait de petits symboles et d’habitudes de consommation.
Le point d’orgue de l’oeuvre est certainement la chanson « Ce poulet du dimanche » :
Ce poulet du dimanche il est d’gauche
Ce soleil sur les branches il est d’gauche
En juillet les casse-croûte sur les aires d’autoroute
De gauche de gauche de gauche !Ce poulet du dimanche il est d’gauche
Cette finale en cinq manches elle est d’gauche
Les corners de Nasri, les contrôles de Messi
De gauche de gauche de gauche !Ce poulet du dimanche il est d’gauche
Ce poulet du dimanche
Cette cousine à Villefranche elle est d’gauche
Les ch’veux qui dégoulinent quand tu sors d’la piscine
De gauche de gauche de gauche !
On notera à toute fin utile que Vincent Delerm est le fils de Philippe, écrivain qui se fit connaître par le recueil La Première gorgée de bière : une ode aux petites choses insignifiantes de la vie, dont ce « poulet du dimanche » pourrait tout à fait constituer le plat de résistance. Mais, là où le père se contentait de dépeindre les plaisirs oisifs d’une vie semi-bourgeoise, le fils les revendique comme étant des marqueurs politiques. Or, ce poulet n’a évidemment rien de gauche, pas plus que la flânerie ou l’achat d’un sandwich sous emballage sur une aire d’autoroute. On pourrait même s’amuser à le trouver atrocement tribal, traditionnel et réactionnaire, ce poulet rituel sacrifié un dimanche sous le coutelas patriarcal, dépecé et réparti entre les membres du clan selon une justice distributive des plus opaques !
Ce qui est assurément de gauche, en revanche – de cette gauche chantée par Vincent Delerm du moins – c’est de ne pas soupçonner qu’on savoure les mêmes instants bénins de l’autre côté du spectre électoral. Ce qui est de gauche, c’est l’orgueil que l’on tire d’une « cousine à Villefranche » prétexte à aller déjeuner au-delà du périph. Ce qui est de gauche, c’est de prendre ces petites choses naturelles et éternelles pour des acquis méritoires, de se les approprier et d’en déposséder l’Adversaire, de lui en contester la coutume aussi apolitique et « universelle » qu’elle soit.
L’Homme de droite, me semble-t-il, a pour lui de se percevoir de droite, c’est-à-dire de décalé par rapport à un centre, une « moyenne » des Français avec qui il faut composer et trouver compromis. L’Homme de gauche Delerm, à l’inverse, se déclare « plutôt de gauche » avec une presque modestie mais se perçoit en réalité comme le centre et finalement comme le tout : puisque tout ce que la vie a de positif lui appartient et qu’il rejette loin de lui ce qu’elle a de négatif, comment ne pas être de son côté et tomber d’accord avec lui ? Quelle ordure faudrait-il être pour ne pas abonder dans sa conception des choses ? Toute personne digne de ce nom, dans l’idée qu’il s’en fait, gravite logiquement dans son champ d’opinions, ou pas trop loin en tout cas, à moins d’être un parfait enfoiré voire un monstre. Afficher l’humilité de ses habitudes (la piscine, le poulet…) ne l’empêche pas d’attribuer un mérite moral à les expérimenter, une supériorité philosophique qui s’acquiert à moindre coût.
Et l’on constate avec amusement que ce défaut est en train de passer du côté d’une certaine droite conservatrice, qui se pare à son tour, sous prétexte de « lutte culturelle », de ses atavismes sociaux et qui fait par exemple de sa bavette snackée au barbecue un acte d’affirmation politique.